 Chère Emma Becker,
Chère Emma Becker,
Un jour, me rappeliez-vous dans votre dédicace, je fus votre premier. Le premier journaliste à vous interviewer : c’était à la sortie de Mr, et c’était pour Standard - paix à l’âme de ce magazine qui n’en manquait pas.
Je doute que cela vous ait beaucoup ému, je suis sûr que vous saviez déjà qu’il y aurait d’autres livres, et d’autres interviews. Et puis, nous n’étions pas totalement inconnus : nous nous étions déjà croisés dans les pages, puis le boudoir burlesque d’une revue gentiment licencieuse nommée Stupre.
Je me souviens encore de ce que vous disiez à la toute fin de notre entretien :
Je veux un jour ouvrir un bordel à Berlin. Un bordel à l’ancienne, comme chez Maupassant. Un endroit classe où les hommes viendraient bien habillés et où les filles aimeraient vraiment baiser. Je sais, c’est une utopie… Mais je vous préviens : si je n’ouvre pas ce bordel, je deviens sexologue.
Vous aviez 20 ans, et je l’avoue, je n’y avais vu qu’une réponse joliment bravache. J’avais tort.
Nous nous sommes revus, de loin en loin (savez-vous qu’il m’arrive encore parfois de manger l’aligot là où…? mais pardons, je m’égare), puis vous êtes effectivement partie à Berlin. Vous avez publié votre deuxième roman, Alice, dont je crois savoir qu’il ne fut pas épargné par la critique. Tel est le lot, je le crains, des jeunes autrices lancées très tôt dans l’arène médiatique - ces "nouvelles Françoise Sagan" à qui tous les Beigbeder du monde ne font jamais de bien. C’était injuste, car le livre comportait des pages magnifiques. Mais c’est ainsi.
L’ironie veut que j’aie lu le roman à Berlin, à l’époque, sans me douter de vos activités à deux quartiers de là.
J’avais appris - me l’aviez-vous dit vous-même ? - que vous travailliez dans un bordel. Mais allez savoir, naïveté confondante ou pruderie atavique, je ne pensais pas que vous y officiiez comme prostituée. Cela, je ne l’ai compris qu’en ouvrant la porte de La Maison.
Mon doigt se pose sur la sonnette ; à l’intérieur, étouffée, une trille désuète, un chahut de petites filles qui s’interrompt brusquement et reprend à mi-voix. J’entends déjà les pas de la Hausdame mais, dans le bref instant qu’il lui faudra pour se faufiler entre les filles, je remplis mes poumons de l’air qui stagne sur le palier, cet art qui est déjà un philtre (…) Dans dix ans, lorsque l’open space aura changé vingt fois de locataires, qu’on aura fait et refait les peintures, il y aura toujours sur ce palier cette odeur que personne ne pourra expliquer - sinon les Berlinois qui se souviendront des queues sorties dans la pénombre des chambres et des chattes lavées à grande eau, à grand bruit, dans les bidets depuis longtemps détruits.
(La Maison, Emma Becker, Flammarion, p. 63)
Ainsi donc, vous avez franchi le pas. On me dit qu’ici ou là, on vous reproche de l’avoir fait "pour l’expérience littéraire" (car je vois qu’il fait partie de ceux dont on parle, et je m’en réjouis - pour vous, et pour lui - on parle si mal de sexe, d’ordinaire, dans ce pays, vous ne trouvez pas ?). Je vous connais peu, mais je sais que c’est faux. J’imagine qu’entre la pute et l’écrivaine, pendant deux ans, les rapports n’ont pas été simples. Il reste quelques traces de ces débats intérieurs dans le livre, elles sont parfois maladroites, on vous les pardonnera volontiers. Car de bout en bout, La Maison m’a semblé honnête - et je l’écris ici dans son sens le plus noble.
Honnête, et neuf. Car la littérature a depuis longtemps figé l’image de la prostituée - double image : celle de la fille paumée victime d’infâmes trafiquants, et celle de la pute au grand coeur qui a tout compris de la vie.
C’est peu de dire que vous passez au large de ces deux clichés, pour montrer une facette que l’on voit si rarement : celle de la pute qui choisit son métier, celle qui doute, celle qui règne - et puis, la vie d’un bordel, non pas au temps de Maupassant mais au XXIe siècle. En parlant de votre expérience, vous parlez aussi des hommes en général et des clients en particulier, des Albanais qui tiennent cette maison concurrentes, et des autres prostituées de la Maison. C’est qu’on ne parle jamais de celle qui joue à Candy Crush en attendant le client qui ne vient pas ; de celle qui accepte un dernier client malgré la fatigue, pour le plaisir de battre un record ; ou de celle qui se démaquille avant de sortir et croise dans la rue un de ses réguliers.
Parmi les pages que j’ai préférées, je crois, il y a celles qui se situent à la frontière entre les deux mondes : celui de la Maison et celui de la rue - ce moment où le client tombé amoureux de Gita la découvre avec un ami, un vrai, et comprend qu’ils vont coucher ensemble et qu’elle en aura envie (c’est page 115 et c’est dommage, si près de la 111).
… Et donc, je le redis : cette Maison a peut-être parfois les cloisons qui branlent, mais pour ma part, je n’avais jamais lu ça. En cette période où les débats s’hystérisent (si on peut encore utiliser ce mot), il comporte une vraie sagesse - une sagesse qui n’a pas peur des mots crus, et qui parle du sexe comme on devrait parler de tout, sans rien cacher sous des draps, des gloussements, ou des mots un peu trop beaux. Et je vous dis merci, en vous souhaitant que cette Maison de papier ne manque pas de visiteurs.
A la vôtre.
(au fait, le savez-vous ? j’ai toujours votre Septentrion)
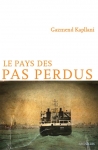 En pleine lecture des pages 111 de la Rentrée, quelques grandes tendances se dessinent, et parmi elles : l’omniprésence de la famille, le retour (timide) du politique et le thème toujours croissant des migrations.
En pleine lecture des pages 111 de la Rentrée, quelques grandes tendances se dessinent, et parmi elles : l’omniprésence de la famille, le retour (timide) du politique et le thème toujours croissant des migrations. Chère Emma Becker,
Chère Emma Becker,