Je n’ai jamais parlé ici d’Erwan Larher, je crois, ou alors juste en passant. C’est idiot.
J’aurais pu le faire en 2010, quand il a publié son premier roman – Qu’avez-vous fait de moi. A l’époque je ne le connaissais pas mais nous étions déjà copains de blogs (le sien est ici). Foot, livres, politique, petits concerts et grandes décisions : il y avait de quoi nous rapprocher.
Qu’avez-vous fait de moi m’avait fait un certain effet. D’abord par sa similitude avec Hors jeu (du personnage jusqu’au nombre de pages), puis par simple plaisir de lecture. J’avais été impressionné, aussi, par la façon dont il parvenait à imbriquer le réel et le fantasmé. J’en avais fait la chronique dans Standard, une de mes premières, du coup je n’en avais rien dit ici.
Idiot, je vous dis.
Puis j’ai rencontré Erwan, et c’est devenu un ami, entre un dîner et un salon du livre, lui dans le Berry et moi à Paris, moi en Hollande et lui en Mélenchon.
La vérité, je dois l’avouer, c’est que je suis un peu jaloux d’Erwan Larher. De son énergie, de sa foi dans l’écriture, des ponts qu’il a coupés et de la liberté qu’il a conquise, pour ne plus faire qu’écrire, ou presque, de résidence en résidence, sans domicile fixe.
C’est en résidence qu’il a écrit son deuxième livre, Autogenèse. Là encore, je n’en ai pas parlé ici, mais c’est que je l’avais lu en ami autant qu'en lecteur, donc doublement sévère. Bref. Le succès lui a posé un lapin mais Erwan s’est accroché, avec ce mélange d’orgueil et de modestie qu’on retrouve, je pense, chez tous les bons écrivains : l’orgueil pour s’accrocher malgré les circonstances défavorables (un éditeur absent lors de la sortie du livre, par exemple) ; et la modestie qui pousse à retravailler encore et encore, à demander des avis à des amis sur des textes en cours – et même à en tenir compte.
J’ai lu L’abandon du mâle en milieu hostile voici quelques mois, sur feuilles A4. C’était un texte de jeunesse qu’Erwan avait exhumé, et qu’il avait réécrit jusqu’à ce qu’il ne reste plus de l’original que la moelle, la flamme, le cœur.
L’histoire est celle de la rencontre, sous Giscard, entre un jeune lycéen fils à papa et la nouvelle de l’école – une simili-punkette, cheveux en bataille, vêtements rapiécés et clope au bec, idées de gauche en bandoulière. Ensuite l’amour, les découvertes, l’air du temps, les changements chez l’un, chez l’autre, et au milieu du livre, une surprise qu’évidemment je ne dévoilerai pas, mais qui m’a fait sursauter dans mon lit.
Au-delà des personnages et de leurs énigmes, le livre évoque le tournant des années 80 dans une ville de province (Dijon), mais surtout des années lycées, intemporelles, et des émois étudiants, entre légèreté et engagements. Il y a là une vraie tendresse punk – et après tout, c’est un peu comme les balades rock, c’est ce qu’on fait de mieux dans le genre.
Mais vous aurez compris que pour plein de raisons je suis mal placé pour vous en faire l’article (vous n’aurez qu’à aller voir là, ou là). Je me limiterai donc à deux éléments factuels :
1. En ouvrant le livre dans sa version imprimée, j’ai que le début n’avait plus rien à voir avec la version précédente.
Je te haïssais. Avec tes cheveux verts, sales, tu représentais tout ce que j’exécrais alors : le désordre, le mauvais goût, l’improductive et vaine révolte juvénile (…)
(Oui, Erwan aime bien inverser le noms et les adjectifs. Nous avons quelques autres désaccords du même type, mais après tout chacun sa personnalité - ça lui va bien, et à son livre aussi, finalement.)
J’ai relu l’ensemble, impressionné par la capacité d’Erwan à réécrire son texte – à le couper, certes, mais aussi surtout à ajouter des passages entiers sans alourdir l’ensemble, au contraire. Ce n’est certes pas une raison pour aimer un livre (seule compte la version finale) mais c’est une raison de plus d’être jaloux, et pas qu’un peu.
2. Certains de ces extraits ont été lus l’autre soir, dans une librairie. Nous étions une cinquantaine, entre chips et vin blanc. Pas exactement en milieu hostile, donc – mais j’en ai connu, des lectures trop longues ou presque gênantes, et l’attention polie qui se transforme peu à peu en bruit de fond – le bruit du flop quand les mots tombent à plat. Rien de tout ça cette fois-ci. Les lecteurs étaient talentueux, les oreilles attentives. Certains s’étaient assis par terre comme des enfants face à un conteur. Et dans la librairie, les gens ont ri.
C’est si rare, finalement.
Et c’est bon.
Vous voilà prévenus.
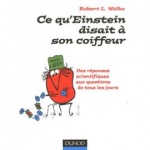 Il a beau se passer quelque chose à chaque fois que je vais chez mon coiffeur à 7 euros du bvd Ornano, ce matin je pensais vraiment qu’on ne parlerait que de météo
Il a beau se passer quelque chose à chaque fois que je vais chez mon coiffeur à 7 euros du bvd Ornano, ce matin je pensais vraiment qu’on ne parlerait que de météo