La veille au soir, la pression avait commencé à monter sérieusement. Sur la table, bières, crudités et sauce cocktail. Et les vraies questions.
- Dis-donc, l’écrivain, j’ai lu les Inrocks, il paraît que t’as tes chances, pour le Flore…
- Ce serait le début de la gloire, mon pote ! La télé à tes pieds !
- Tu crois vraiment qu’on peut avoir le Flore sans être passé à la télé avant ?
- En tout cas, faudra que tu refasses une garde-robe, si t’as le prix…
- ... Et surtout si tu l’as pas.
- Eh les gars, vous avez vu la bombe, là-bas !
Finalement, on avait conclu qu’il ne fallait pas attendre les 6 000 euros du prix pour acheter des chemises neuves – que le relooking était un investissement, pas une récompense. Plus tard dans la soirée, Laurent m’avait offert Le Bûcher des Vanités en DVD. "Pour calmer tes nerfs", il m’avait dit. Et c’est le lundi, au moment où Tom Hanks, excédé, chassait à coups de fusil les invités du cocktail de sa femme, que mon portable a sonné pour m’annoncer que j’étais la nouvelle Flore. Il était 14h14, je n’avais plus d’ongles et je quittais enfin le level beginner de la vie littéraire.
Rock n’ Roll.
Juste après l’annonce, j’ai eu droit au quart d’heure Danièle. Dans les nouvelles du Flore, l’attachée de presse joue toujours un rôle important, l’après-midi du prix – à la fois hystérique, semi-fantasme et mère-poule d’un jour. D’habitude, le Flore récompense des maisons où l’attachée s’appelle Félicia, Charlotte ou Lydie. Moi, j’avais Danièle, qui jetait sur moi le regard sévère et plein de tendresse d’une gouvernante de bonne maison. Elle avait déjà fait tous ses calculs : qui serait là, avec qui et pourquoi, ce qu’il faudrait dire, comment s’habiller… Elle a passé en revue tous les codes de l’élégance début de siècle, et quand elle a vu que je ne quittais pas mon petit nuage elle a conclu, philosophe: "de toute façon, il paraît que vous tenez bien l’alcool, donc tout devrait bien se passer."
Puis, regardant sa montre, elle m’a annoncé avec un sang froid extra-terrestre qu’il me restait deux heures pour appeler mes proches avant qu’ils n’apprennent mon triomphe par la radio.
 Je n’avais aucune envie d’arriver à l’heure. A 19h15, quand le taxi nous a déposés – mon éditeur, Danièle et moi –, c’était déjà la cohue devant le Flore. "Une petite cérémonie en famille", m’avait dit Carole Chrétiennot au téléphone… D’ordinaire, je me serais déjà enfui, mais Danièle me tenait la main. Elle a soulevé un sourcil, et aussitôt nous avons été happés par les formalités d’arrivée : photos, interviews express et compliments préparés.
Je n’avais aucune envie d’arriver à l’heure. A 19h15, quand le taxi nous a déposés – mon éditeur, Danièle et moi –, c’était déjà la cohue devant le Flore. "Une petite cérémonie en famille", m’avait dit Carole Chrétiennot au téléphone… D’ordinaire, je me serais déjà enfui, mais Danièle me tenait la main. Elle a soulevé un sourcil, et aussitôt nous avons été happés par les formalités d’arrivée : photos, interviews express et compliments préparés.
Après une demi-heure, Danièle s’est détachée – opération RP, tu prends à droite, je prends à gauche, on se rejoint à la caisse – et je me suis retrouvé seul, tête pleine et mains vides. J’ai pensé à mon premier cocktail, un 14 juillet à l’Ambassade de France au Caire. Les bonnes sœurs piétinaient les sous-consuls pour accéder à la charcuterie et au vin rouge, tandis que les huiles étaient en retrait, toujours servies. Soudain, j’ai eu un flash : dix ans plus tard, je revivais la même scène, avec Jean-Luc Lemoine dans le rôle de la bonne sœur ahurie, un chroniqueur de Canal + dans celui du jeune diplomate aux dents longues, et des canapés au foie gras dans le rôle de la charcuterie. Sans oublier Philippe. Sollers. Le premier que je voyais parmi ceux qui comptent vraiment. Bien sûr, je l’avais déjà croisé de loin, dans des cocktails où je jouais au pique-assiette, et je me disais qu’être dans la même pièce que lui était un début de réussite, mais ce soir il me jetait des regards en coin – il avait dû voir ma tête sur la jaquette que mon éditeur m’avait offerte pour le 3e tirage. Ou alors il y avait écrit "lauréat" sur une auréole pas loin de moi. Ou alors c’est juste qu’un inconnu avec des photographes autour, c’est forcément le type qui a gagné quelque chose.
Un des compagnons de Sollers (une tête de type important) m’a salué et a levé la main. "Du champagne pour notre ami!", il a dit, et peu après j’ai été repris par le flux des Merci, Vous me gênez, Oh vous savez – sans oublier le fameux Oui je travaille sur un nouveau roman mais bon je peux pas encore trop vous en parler… En me dandinant d’un pied sur l’autre. Merde, j’étais en train d’oublier que c’était moi la rock star et que tout m’était dû !
Heureusement, j’ai vu arriver vers moi Christophe Tison et sa tête de journaliste sportif, accompagné de la muraille Carcassonne, et tous les deux m’ont transporté au-dessus de la gomina, des permanentes et des effets saut du lit jusqu’à l’estrade, enfin les choses sérieuses allaient commencer.
Trois petites marches, et soudain je prenais plus de hauteur que je n’en avais jamais rêvé. Le roi Frédéric en personne m’a fait un clin d’œil avant d’annoncer en Beigayant qu’après avoir terrassé un à un tous ses adversaires (tiens, il n’avait pas voté pour moi), l’auteur d’Eliminations directes était le lauréat 2006. Applaudissements.
La suite se passe très vite. Gaspard Koenig, floré en 2005, me dit Ben mon salaud et remet le chèque, mais Viviant l’intercepte, théâtral. "Mais oui, dis-donc, c’est vrai qu’ils l’ont augmenté, ce prix !", et il montre le chèque à Vandel qui rigole et passe à Tison qui passe en retrait à Saint-Vincent, qui trouve Reynaert dans la profondeur... J’ai déjà vécu la scène : je suis le petit 6e dans la cour de l’école, les grands de 3e ont piqué ma balle et jouent avec, ils se la passent au-dessus de ma tête et à chaque fois que j’essaie de la récupérer, hop, une nouvelle passe et un rire gras.
Depuis la 6e j’ai fait quelques progrès, catégorie Dignité et Vie sociale. Pour éviter l’humiliation, ne surtout pas bouger. J’ai l’impression qu’ils jouent avec mon chèque depuis au moins une demi-heure, mais en temps réel pour les spectateurs ça doit juste faire 15 secondes, autant faire semblant de m’amuser avec eux, ha ha, quels blagueurs, bon on arrête ?
Mais c’est con, un grand de 3e, et c’est endurant. Rassemblant mes énergies, cramponné à ma fierté, je cherche le maillon faible. Pourquoi j’ai choisi Reynaert ? Aucune idée. Peut-être parce qu'il avait l'air le plus sympa. Je me concentre – ça y est, il tient mon chèque et je tiens mon truc : je le fixe, tends tous mes neurones vers lui, et je l’imagine dans les couloirs de l’Obs, veille de bouclage, promenant sa grande carcasse dégingandée dans les couloirs en apostrophant les journalistes, "eh lis un peu, pas mal cette vanne, non ?"
Le talisman fait effet en quelques secondes : son sourire se fige, il cherche un collègue mais plus personne ne veut jouer au chèque avec lui, alors il me le rend et Beigbeder, sonnant la fin de la récré, annonce que maintenant que je suis riche, je peux prendre le micro. First level completed. 6 500 euros.
Mon éditeur m'avait prévenu : les moments de grâce sont rares. Regarde bien la salle avant de parler, il m'avait dit avant d'aller taper dans le dos d'un membre du jury. Je me suis souvenu du conseil.
Balayant la salle, j'ai croisé tous les regards : ceux qui étaient contents pour moi et tous ceux qui étaient juste contents d'être là. Alors la Lumière est descendue sur moi. Ce bref moment de lucidité où l'on voit tout (que Lolita Pille a des petits seins, par exemple, ou qu'au fond Guillaume Durand est juste un mec qui aimerait tant s'aimer), où soudain notre propre trajectoire semble rectiligne. Le moment aussi où on se lance sans papier dans un discours qu'on avait pas prévu. Le rock n'roll, par exemple.
Quelques années avant Eliminations directes, j'avais écrit un recueil de nouvelles comme un bon vieux disque de rock au temps du vinyle : une face A, une face B, trois 45-tours potentiels pour assurer ma place dans les charts, une moitié de morceaux bien ficelés mais sans génie (ou l'inverse) et quelques titres plus ardus dont j'étais plutôt fier - ceux que les vrais fans réclameraient plus tard en concert, les premiers du culte. Mais les éditeurs ne sont pas très rock n'roll, et l'album qui devait faire ma gloire était longtemps resté en version démo. Loin des grandes scènes, j'en jouais de courts extraits sur l'estrade de la salle des fêtes d'une ville de province qui organisait un concours et me donnait le 2e prix derrière M. Chiant. « Parce que vous comprenez l'histoire on aime beaucoup, c'est très drôle, mais M. Chiant a une écriture si personnelle, tellement ciselée... » Ensuite, il y avait toujours un cocktail où je passais inaperçu et que je quittais poliment pour aller boire dans un bar avec un flipper. C'est dire si je n'étais pas préparé, pour le Flore.
Je leur ai raconté ça, et plein d'autres choses encore. J'avais prévenu ma complice Lavinia, de France 3, que je ferais un jeu de mots dès la deuxième phrase et elle a lancé les rires avec un talent fou. Ensuite, tout s'est déroulé comme un tapis rouge à roulettes, il ne manquait plus que l'orchestre ponctuer chaque blague d'un tonnerre de cymbales - tout marchait tellement bien que j'ai failli demander à l'humoriste officiel, qui était à me droite, de prendre des notes.
 Après ma conclusion, sous la mitraille des photographes, Michèle Fitoussi m’a glissé à l’oreille « Allez-y, Bertrand, profitez ! » Aujourd’hui encore je frissonne à l’évocation de son vouvoiement. Aujourd’hui seulement je comprends que je n’ai profité de rien. A part le champagne, bien sûr. Impossible de repenser à une image de cette soirée sans me voir une coupe à la main – la gauche, surtout, parce que la droite était toujours occupée à en serrer d’autres pendant que je zappais entre toutes les conversation. Bernard Wallet parlait de Beyrouth, Laurent Habart de l’Himalaya et Christophe Ono-dit-Biot de ce petit restaurant tellement exotique dans le 19e arrondissement. Charles Pépin, nouveau juré, avait l’air d’un jeune HEC qui vient d’enlever sa cravate et discutait Remix avec l’attachée de presse du Diable Vauvert en s’efforçant de la regarder dans les yeux sans se caser la nuque. Et Anna, enfin. Anna Gavalda, belle et droite, reine et digne, commandant un cocktail abricot-mangue.
Après ma conclusion, sous la mitraille des photographes, Michèle Fitoussi m’a glissé à l’oreille « Allez-y, Bertrand, profitez ! » Aujourd’hui encore je frissonne à l’évocation de son vouvoiement. Aujourd’hui seulement je comprends que je n’ai profité de rien. A part le champagne, bien sûr. Impossible de repenser à une image de cette soirée sans me voir une coupe à la main – la gauche, surtout, parce que la droite était toujours occupée à en serrer d’autres pendant que je zappais entre toutes les conversation. Bernard Wallet parlait de Beyrouth, Laurent Habart de l’Himalaya et Christophe Ono-dit-Biot de ce petit restaurant tellement exotique dans le 19e arrondissement. Charles Pépin, nouveau juré, avait l’air d’un jeune HEC qui vient d’enlever sa cravate et discutait Remix avec l’attachée de presse du Diable Vauvert en s’efforçant de la regarder dans les yeux sans se caser la nuque. Et Anna, enfin. Anna Gavalda, belle et droite, reine et digne, commandant un cocktail abricot-mangue.
Toutes les femmes de plus de 50 ans sont venues me présenter leurs ardentes félicitations. Comme dans les mariages, après mes discours : un carton auprès des tantes et des grands mères, mais impossible de me taper la petite cousine célibataire. J’espérais que tout serait différent avec le prix, mais les bimbos officielles avaient déjà bien trop à faire avec le people confirmé. A part Léa, peut-être. « Je suis une ex de Florian Zeller, elle m’a dit. Tu veux jouer au cocktail avec moi ? » Elle m’a parlé des écrivains qu’elle connaissait. « Tu sais, elle m’a dit entre deux gorgées de vodka, j’ai tout compris sur les mecs, dans ce milieu. Avec les femmes, ils n’ont qu’une règle : en changer souvent, l’échanger parfois ». Sur ce, saoule et offerte, elle m’avait adressé un sourire implacable, mais j’ai à peine le temps de goûter la fermeté de ses petits seins contre ma chemise que mon éditeur me tirait par la manche pour me présenter une de ses amies libraires. Ah, Léa ! Hier, j’ai pensé à toi.
Vers la fin, je me suis retrouvé avec Emmanuel Pierrat, avocat et agent, qui expliquait que d’Ormesson avait battu le record de droits d’auteur pour sa nouvelle tournée d’adieu sur les plateaux télé. Tout en racontant ses histoires, il menaçait d’intenter un procès au Flore s’il n’avait pas une nouvelle coupe dans les dix secondes. J’ai imaginé la même scène un peu plus tôt chez Jacques Dessange et je suis parti d’un fou rire. Une certitude : j’avais atteint ma limite éthylique. Une autre : je m’en foutais.
Dans mon dos soufflaient le vent du succès et le parfum d’Aude Lancelin. La belle Aude. J’ai eu envie de lui dire que j’avais repéré sa plume dans l’Obs bien avant qu’elle ne passe à la télé (à cet instant, cela me semblait être le compliment ultime) – mais trop tard, on l’avait vue à la TV et le flot de courtisans l’a emportée avant que je n’aie pu l’approcher. En me retournant, j’ai aperçu Michèle Fitoussi qui me souriait de loin – un sourire plein d’une sollicitude ironique qui semblait me demander : « Alors ? » Je lui ai fait un signe négligé de la main, pensant que tel était l’usage.
Il était 21h50 et je subissais totalement les événements.
 Lorsque la porte des toilettes s’est refermée, j’ai enfin goûté un peu de solitude. Dans le miroir j’ai vu le type de la veille qui n’avait pas encore le Prix et je l’ai salué. Il avait une tête sympathique. Un peu parti, sans doute, un peu naze, peut-être, mais il me plaisait bien. Il me semblait fidèle. Pas du tout la tête du type qui va bientôt dîner à la Closerie des Lilas, par exemple.
Lorsque la porte des toilettes s’est refermée, j’ai enfin goûté un peu de solitude. Dans le miroir j’ai vu le type de la veille qui n’avait pas encore le Prix et je l’ai salué. Il avait une tête sympathique. Un peu parti, sans doute, un peu naze, peut-être, mais il me plaisait bien. Il me semblait fidèle. Pas du tout la tête du type qui va bientôt dîner à la Closerie des Lilas, par exemple.
A ce moment, l’orchestre a entamé une rumba, et le type dans la glace a eu ce rictus que je connais bien - le plissement de lèvres de celui qui vient d’avoir une intuition géniale.
Je me suis passé la tête sous l’eau, pour avoir les idées plus claires. Mais en fait d’idées je n’en avais plus qu’une – l’Idée du siècle, assurément, celle dont l’underground littéraire parlerait bientôt avec des éclairs dans la voix. Il était temps que je reprenne la main. Derrière la porte capitonnée des toilettes du Flore, Paris n’avait qu’à bien se tenir.
- Toi, tu m’as l’air bien attaqué ! m’a dit S., ma copine de l’Obs, qui parce qu'elle avait lu mon roman ne se sentait pas obligée de m’en parler.
- Je suis peut-être à deux doigts de la cuite monumentale, mais seulement à un quart d’heure de la postérité, j’ai répondu avant de lui exposer mon plan.
- Tu es complètement taré ! elle a conclu en rigolant.
Puis elle a promis de m’aider.
Un quart d’heure et quelques conciliabules plus tard, j’étais de retour dans la fosse.
Le peuple avait commencé à se disperser et le photographe du Flore, terminant sa pellicule, immortalisait l’exposition annuelle de coupes de champagne à moitié vides sur nappes tachées. Je connaissais le script : bientôt, Beigbeder allait annoncer le départ des dominants vers la Closerie, avec le lauréat (moi), et la Grande Sélection allait s’opérer. Comme au Tour de France, j’ai pensé, dans les étapes de montagne : chaque matin le peloton part groupé, mais à l’attaque du dernier col on retrouve toujours les 30 meilleurs grimpeurs, accompagnés d’un outsider. Ce soir, c’est moi la surprise, j’ai pensé. Et non seulement j’allais m’accrocher jusqu’à l’arrivée, mais j’allais tenter l’échappée du siècle. Matez le panache.
Je sentais tellement bien mon coup que je l’ai joué à l’instinct. Infaillible. Comme si j’étais né pour ça. Au moment où le roi allait prendre la parole pour s’adresser à ses sujets, je me suis hissé sur l’estrade.
« Oh yeah, oh yeah, jeunes gens ! »
Je ne sais pas si j’étais très convaincant ou juste très saoûl, mais tout le monde a bien réagi. Le public a applaudi, et l’orchestre a emmanché Satisfaction au moment où je criais "Rock n’roll !"
Au fond, rien de plus légitime : j’avais le Prix, j’avais discouru, j’avais bien le droit à un rappel pour finir en pleine gloire. Ils m’écoutaient tous avec d’autant plus d’attention qu’ils étaient persuadés que je n’étais là que pour déconner.
J’ai commencé soft.
"Permettez-moi de porter un dernier toast aux treize ans du Prix de Flore... (applaudissements nourris sur la gauche, exclamations) Ah, treize ans ! L’âge de l’éternelle adolescence : la révolte, la soif de liberté, l’insolence, les opinions sans concession... Au fond, il me semble que le Prix de Flore a toujours eu treize ans ! (cris de joie dans l’assistance, quelques bravos) Mais attention ! ("Oh!" surjoués sur la droite) Il se passe tant de choses en treize ans... En 81, Mitterrand choisissait Mauroy, en 94 il en pinçait pour Balladur. En 55, Elvis chantait Hound Dog… Et que faisait-il pendant Woodstock en 68 ? De la varièt’ molle à Las Vegas. C’est pourquoi, en vérité je vous le dis : attention ! A l’ombre des jeunes rebelles en Flore, l’embourgeoisement menace. Il est à nos portes – celles de la sortie. Chaque année le même rituel: les grands ducs à la Closerie, les barons chez Lipp et les valets dans leur chambre… A ce rythme là, ce n’est plus l’embourgeoisement qui vous guette, c’est l’Ancien Régime !"
Dans la salle, le silence s’était fait, attentif, circonspect. Il était temps de conclure.
"… Donc pas de Closerie, ce soir. Et pas de Castel. Je vous emmène chez Kamel ! La Gouttière, rue Parmentier – il y avait un concert de Temper, ce soir. On y va tous. Et on y va en métro !"
Outre S., j’avais mis dans la confidence Lavinia et les libraires de Brassens. En sortant des toilettes, j’avais croisé Sollers. Je l’avais pris par le bras et il avait rigolé. « T’as raison petit, moi j’allais me coucher, mais vas-y, je reste pour voir ça, il faut les bouger ces petits Flore. » Soixante-treize centièmes de seconde après ma dernière phrase, Philippe a sifflé « Bravo ! », puis sur la gauche j’ai vu deux types avec Lavinia, morts de rire, qui levaient leurs verres en criant "T’es not’ chef, Cartouche !". Et petit à petit, dans tout le Flore, le peuple s’est levé pour acclamer son libérateur. - Tous Chez Kamel ! - Fermons la Closerie ! - For those about to rock ! - Vive le Flore libre ! - Montjoie, Saint Denis ! - Il nous a compris !
Après l’enthousiasme, il a fallu transiger un peu. Avec ceux qui voulaient y aller en voiture, ceux qui ne prenaient que le taxi, ceux qui avaient un rendez-vous, les fatigués… et tout le ventre mou du people pop, qui attendait de voir ce que ferait le roi pour se prononcer. J’ai regardé Beigbeder, qui semblait encore hésiter, pas hostile. D’un geste de la main, je lui ai signalé que je lui laissais le choix final. Il n’avait pas besoin de plus. « On y va ! » il a lancé en sautant de l’estrade - et aussitôt Viviant l’a rejoint, sautant sur l’occasion. « Forever young ! »
Quelques instants plus tard, ils étaient vingt à me suivre dans le métro – dont Beig lui-même, qui avait bien compris la portée symbolique du truc. Sur le quai, les gens nous mataient furieusement mais personne n’osait bouger, on est une bande, je me disais, une vraie meute, intouchables.
J’étais au sommet.
Les vitres de la Gouttière portaient une sévère buée de sueur et de clope. Temper avait rempli la salle. Il y avait là tous les âges, tous les sexes, tous les goûts et aucun look. Flore ou pas, l’arrivée d’une vingtaine de littéraires faisait un peu défilé de mode. Kamel m’a salué de loin entre deux mojitos et une addition.
Devant le zinc, trois rangées d’habitués se vannaient, verre à la main, rendant l’accès incertain. Les Flore ont marqué le pas. J’ai bien vu qu’ils avaient perdu l’habitude d’attendre, c’était à moi d’y aller – le King, at home !
« J’y vais pour tout le monde », j’ai annoncé, étrennant mon costume à peine froissé de leader charismatique d’une nouvelle génération littéraire. Carcassonne m’a accompagné, et sur le moment, j’ai pensé que c’était par défi. Arrivé près du but, devant la tireuse, j’ai été pris d’une nouvelle Intuition et me suis retourné.
- Oh les gars, demi pour tout le monde, on est rock n’roll ou pas ?
S’il disaient oui, ma fortune était faite. Mais Carcassonne est intervenu.
« Tu sais que Mick Jagger n’a pas bu de demi depuis 1976 ? », il m’a fait, impassible. Et dans la foulée il a demandé à Kamel de sortir sa réserve de champ’.
Et la Gouttière a connu la folie. Dans le sillage de Nicolas Rey, dont la chemise à pois rouges avait attiré deux groupies, le Flore a commencé à se mélanger à la faune du lieu. Kamel a remis à fond un coup de New place, new face.
"Longtemps que je ne m’étais sentie aussi jeune !", s’est écriée une auteure à la mode d’hier, en regardant avec Viviant les affiches de concerts militants collées aux murs, tandis que le jeune Shepuki, fils à papa déchu, faisait le toue des tables, bouteilles en main, pour servir tout le monde. Deux types de Tchnikart se sont rapprochés de moi pour débattre de l’émergence d’un Oberkampf Revival. C’est pas innocent, ce qui se passe ce soir, disait le moins saoul.
Entre deux gorgées de petit lait, j’ai surpris Beigbeder en grande conversation avec Montal, le guitariste de Temper. Il parlait en s’imitant : "Aujourd’hui, c’est le marketing qui est rock n’roll, mon pote !", disait-il en faisant de grands gestes un peu désordonnés, entre accord de guitare et comptage de billets.
En une demi-heure, tout le champagne était bu. Taddei a voulu se resservir, mais deux types qui ne l’avaient pas reconnu lui ont barré l’accès du zinc. Il s’est penché vers Carcassonne, très sérieux, puis tout s’est enchaîné aussi vite que mes illusions m’avaient grisé.
Il n’était même pas minuit et mon carrosse se transformait déjà en citrouille. Au moment où j’allais proposer de remettre ça pour tout le monde, Beigbeder a lancé le repli vers la rive gauche. Le message était clair : veni, vidi, Closerie, il était temps de retrouver la cour des grands. 45 tours et puis s’en vont. Je n’avais rien vu venir.
Scotché au zinc, j’ai dû les regarder partir un à un, incapable de suivre. Les suivre pourquoi, au fait ? J’avais oublié. En sortant, je crois que Tison m’a souhaité bonne nuit. Mais je ne suis plus sûr de rien.
Depuis lors, je fouille en vain mes souvenirs à la recherche de ces cinq minutes de trou noir. Il paraît qu’on m’a parlé, que Kamel a tenté de me secouer, il ne peut pas sentir les pique-assiette mais il sentait bien qu’il se jouait quelque chose d’important. il paraît aussi que Taddei et Vandel sont revenus me chercher et que j’ai dit que je les rejoindrais plus tard. Mais je ne suis plus sûr de rien. Sauf d’une chose : quand une chance passe, elle passe très vite.
Putain de merde, quand même, j’étais si près ! J’aurais pu être mythique parmi les mythiques, on aurait parlé pendant 50 ans de ce jeune espoir belle gueule qui avait mis dans sa poche le tout Paris en une soirée… Mais là j’étais juste le type tout seul avec son chèque en poche, et un grand vide devant lui.
J’ai pensé à tous ces groupes de première partie qui avaient voulu un jour voler la vedette aux Stones et dont Mick Jagger s’était empressé d’enterrer la carrière. Je n’aurais jamais dû jouer ce coup-là, c’était sûr. On m’avait invité pour un bœuf et j’avais fait la grenouille. Le solo de trop. De l’autre côté de la Seine, on m’enterrait déjà à la Closerie.
Quand j’ai repris pleinement conscience, j’avais face à moi, en gros plan, le visage de Kamel. Il était emmerdé, le pauvre, il ne savait pas comment me le dire. Il n’a pas eu à le faire. En le voyant, j’ai compris tout de suite. Au total, il y en avait pour 860 euros. Mais on pouvait s’arranger bien sûr, il aurait voulu intervenir mais il n’avait pas réussi à en retenir un seul pour lui dire qu... Je l’ai coupé en l’embrassant.
Maintenant c’était clair. J’en referais un, de livre, un qui n’aurait pas de prix.
Alors j’ai demandé un verre d’eau, et j’ai fait un chèque de 1 000 euros.
Rock n’roll.
 Depuis que j'ai l'âge de lire des magazines, je crois avoir toujours lu des articles sur le déclin de la littérature française. Des analyses qui manquent souvent, et cruellement, de bases tangibles. Il y a bien eu, en début d'année, ce long et réjouissant article de Laurence Marie, du Bureau du livre à New York. Mais pour un tel travail, combien de tribunes basées sur de vagues impressions ?
Depuis que j'ai l'âge de lire des magazines, je crois avoir toujours lu des articles sur le déclin de la littérature française. Des analyses qui manquent souvent, et cruellement, de bases tangibles. Il y a bien eu, en début d'année, ce long et réjouissant article de Laurence Marie, du Bureau du livre à New York. Mais pour un tel travail, combien de tribunes basées sur de vagues impressions ?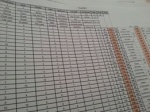 J'ai tenté de pointer d'autres critères plus ou moins objectifs, mais le text-mining manuel a ses limites.
J'ai tenté de pointer d'autres critères plus ou moins objectifs, mais le text-mining manuel a ses limites.  Avant Zeller, il y avait eu Svetislav Basara. Le miroir fêlé est un petit livre absurde, où les personnages perturbent le narrateur en s’immiscant dans certains chapitres. Ainsi, page 50 :
Avant Zeller, il y avait eu Svetislav Basara. Le miroir fêlé est un petit livre absurde, où les personnages perturbent le narrateur en s’immiscant dans certains chapitres. Ainsi, page 50 : Après, il y a eu La disparition de Richard Taylor, d’Arnaud Cathrine, la fuite d’un jeune trentenaire juste après la naissance de son premier enfant, racontée par les différentes femmes qu’il aura croisées en chemin. Toutes les voix sont justes, toutes ou presque cachent quelques pépites d’écriture, c’est un beau roman à picorer. Et une pierre dans le jardin rocailleux des contempteurs de la jeune littérature française.
Après, il y a eu La disparition de Richard Taylor, d’Arnaud Cathrine, la fuite d’un jeune trentenaire juste après la naissance de son premier enfant, racontée par les différentes femmes qu’il aura croisées en chemin. Toutes les voix sont justes, toutes ou presque cachent quelques pépites d’écriture, c’est un beau roman à picorer. Et une pierre dans le jardin rocailleux des contempteurs de la jeune littérature française. Donc, j’ai lu Florian Zeller.
Donc, j’ai lu Florian Zeller. Heureusement qu’on m’avait prévenu. Parce que si j’étais tombé de façon inopinée sur ce "à suivre..." en bas de la page 501, j’aurais peut-être refermé le livre avec un soupçon d’énervement. Alors que là je soupçonne juste Bello (ou Gallimard) de jouer sciemment avec mes nerfs, et jouer, j’adore ça. Donc je serai patient. En attendant, Les Falsificateurs ont tenu leurs promesses.
Heureusement qu’on m’avait prévenu. Parce que si j’étais tombé de façon inopinée sur ce "à suivre..." en bas de la page 501, j’aurais peut-être refermé le livre avec un soupçon d’énervement. Alors que là je soupçonne juste Bello (ou Gallimard) de jouer sciemment avec mes nerfs, et jouer, j’adore ça. Donc je serai patient. En attendant, Les Falsificateurs ont tenu leurs promesses. « Pour la trappe dans le plafond, je ne dirai rien promis. Papa et maman gardent des journaux et des armes là-dedans, mais je ne dois rien dire. »
« Pour la trappe dans le plafond, je ne dirai rien promis. Papa et maman gardent des journaux et des armes là-dedans, mais je ne dois rien dire. » J'allais publier dans la douleur une troisième rencontre mais j'apprends à l'instant qu'après-demain sort chez Gallimard un nouveau roman d'Antoine Bello - Les falsificateurs. Et là, je fais un petit saut de joie.
J'allais publier dans la douleur une troisième rencontre mais j'apprends à l'instant qu'après-demain sort chez Gallimard un nouveau roman d'Antoine Bello - Les falsificateurs. Et là, je fais un petit saut de joie. J’ai passé le week-end en Irlande du Nord.
J’ai passé le week-end en Irlande du Nord. Je n’avais aucune envie d’arriver à l’heure. A 19h15, quand le taxi nous a déposés – mon éditeur, Danièle et moi –, c’était déjà la cohue devant le Flore. "Une petite cérémonie en famille", m’avait dit Carole Chrétiennot au téléphone… D’ordinaire, je me serais déjà enfui, mais Danièle me tenait la main. Elle a soulevé un sourcil, et aussitôt nous avons été happés par les formalités d’arrivée : photos, interviews express et compliments préparés.
Je n’avais aucune envie d’arriver à l’heure. A 19h15, quand le taxi nous a déposés – mon éditeur, Danièle et moi –, c’était déjà la cohue devant le Flore. "Une petite cérémonie en famille", m’avait dit Carole Chrétiennot au téléphone… D’ordinaire, je me serais déjà enfui, mais Danièle me tenait la main. Elle a soulevé un sourcil, et aussitôt nous avons été happés par les formalités d’arrivée : photos, interviews express et compliments préparés. Lorsque la porte des toilettes s’est refermée, j’ai enfin goûté un peu de solitude. Dans le miroir j’ai vu le type de la veille qui n’avait pas encore le Prix et je l’ai salué. Il avait une tête sympathique. Un peu parti, sans doute, un peu naze, peut-être, mais il me plaisait bien. Il me semblait fidèle. Pas du tout la tête du type qui va bientôt dîner à la Closerie des Lilas, par exemple.
Lorsque la porte des toilettes s’est refermée, j’ai enfin goûté un peu de solitude. Dans le miroir j’ai vu le type de la veille qui n’avait pas encore le Prix et je l’ai salué. Il avait une tête sympathique. Un peu parti, sans doute, un peu naze, peut-être, mais il me plaisait bien. Il me semblait fidèle. Pas du tout la tête du type qui va bientôt dîner à la Closerie des Lilas, par exemple.