Où l’on renoue avec des histoires souterraines, sans forcément y chercher une chute.
Samedi, 22 heures, Porte de Clignancourt. Dehors il fait 4° sous zéro, en sous-sol le prochain départ est annoncé dans quatre minutes. Le métro est déjà à quai, quasi vide, je me suis installé à l’avant avec mon écharpe au cou et dans les mains, Un écrivain, un vrai, de P. Petersen, qui jusque là me paraissait très bon.
C’est une de ces rames dernier cri où l’on peut avancer d’un bout à l’autre, et où résonne encore mieux le silence des terminus. Mais bientôt arrivent des hurlements de cour d’école : ce sont trois gamins, entre 5 et 10 ans, qui jouent à qui touchera en premier la cabine du conducteur. Deux gars, une fille. C’est la fille qui gagne (c’est l’aînée). Le père arrive quelques instants plus tard, la quarantaine noire avec déjà quelques poils blancs dans sa barbe. Il s’installe avec ses enfants de l’autre côté du couloir central, nous nous saluons discrètement, puis il explique le métro à ses enfants tandis que je reprends mon livre.
 Tout avance tranquillement jusqu’à Château Rouge où monte un jeune couple. Ils ont déjà bien entamé leur soirée, à moins que ce ne soit l’inverse, les joues sont rouges et ce n’est pas seulement à cause du froid. La fille est habillée avec goût, jupe, collants épais et bottines, mais l’alcool a eu raison de ce qui lui reste de classe, elle rit bruyamment et tout à trac demande à un passager assis sur un strapontin s’il n’aurait pas une clope. Il n’en a pas. Son compagnon tente de la calmer, non mais attends on arrive bientôt, tu pourras taxer Machine, mais la fille apparemment préfère taxer un inconnu, il doit y avoir une vieille histoire avec Machine – en tout cas je serais surpris qu’il y ait déjà une histoire avec son compagnon du soir ; jeans et pull en laine, regard transi (pas de froid) et petit rire gêné quand elle continue de parler trop fort, il n’a aucune chance. Quelqu’un aurait une clope ? tente-t-il pour se mettre au niveau, mais sa remarque tombe dans le vide, il a trop retenu sa voix, elle n’a même pas ri. La représentation est terminée.
Tout avance tranquillement jusqu’à Château Rouge où monte un jeune couple. Ils ont déjà bien entamé leur soirée, à moins que ce ne soit l’inverse, les joues sont rouges et ce n’est pas seulement à cause du froid. La fille est habillée avec goût, jupe, collants épais et bottines, mais l’alcool a eu raison de ce qui lui reste de classe, elle rit bruyamment et tout à trac demande à un passager assis sur un strapontin s’il n’aurait pas une clope. Il n’en a pas. Son compagnon tente de la calmer, non mais attends on arrive bientôt, tu pourras taxer Machine, mais la fille apparemment préfère taxer un inconnu, il doit y avoir une vieille histoire avec Machine – en tout cas je serais surpris qu’il y ait déjà une histoire avec son compagnon du soir ; jeans et pull en laine, regard transi (pas de froid) et petit rire gêné quand elle continue de parler trop fort, il n’a aucune chance. Quelqu’un aurait une clope ? tente-t-il pour se mettre au niveau, mais sa remarque tombe dans le vide, il a trop retenu sa voix, elle n’a même pas ri. La représentation est terminée.
Pendant ce temps, à Barbès, un homme s’est installé en face de moi, la trentaine maghrébine. Il touche ma jambe et s’excuse, courtois. Puis il se penche vers les gamins, attendri, il discute avec les deux aînés tandis que le petit dernier le regarde fasciné. Le père assiste à l’échange sans rien dire, un sourire bienveillant sur son visage las.
On échange des grimaces, les prénoms, les nationalités.
Où l’on apprend que les gamins sont haïtiens et que Khalid, lui, est marocain.
- Maroquoi ? demande le cadet.
- Marocain.
- Tu viens du Maroc ? demande la fille.
Un sourcil du père vient trahir sa fierté, puis il sourit franchement quand mon voisin lève son pouce. C’est peut-être ça qui a mis l’ami Khalid en confiance. Alors il ajoute, sur ce ton bêtement complice de la discussion impromptue de boîte de nuit :
- Eh oui. Maroc. Haschich !
En disant ça il a tendu deux doigts joints dans le signe universel de la bonne petite fumette, le regard "cool, man" ostensiblement tourné vers le petit dernier.
Il n’y aura pas d’autre parole.
Le père n’a même pas esquissé de geste, un bref regard et son autorité naturelle ont suffi.
Il a dû penser comme moi à tous les Khalid un peu idiots et tous ces autres moins gentils que son fils croisera dans les dix prochaines années.
Lui et les enfants descendront à la prochaine station, sans un mot. Sans se retourner, ils passeront devant le petit couple enfin assagi, elle regardant dans le vague, lui tentant de croiser ses yeux.
Khalid, lui, regardera ses pieds jusqu’à ce que je descende à mon tour.
 C’est l’histoire de Bernard, sympathique grenouille de comptoir un peu bourin qui se prend pour un bœuf philosophique et qui, pour tenter de culbuter sa chef Christine, arpente cafés-philos et petites-expos-sympas. Un peu plus loin, il suit même le cul de Corinne dans un musée, et vient cette phrase éternelle :
C’est l’histoire de Bernard, sympathique grenouille de comptoir un peu bourin qui se prend pour un bœuf philosophique et qui, pour tenter de culbuter sa chef Christine, arpente cafés-philos et petites-expos-sympas. Un peu plus loin, il suit même le cul de Corinne dans un musée, et vient cette phrase éternelle : 

 Puis il y eut le roman, en 2010. Il y a si peu d’endroits confortables, c’était un beau titre, et il lui ressemblait. Là encore, j’ai eu très peur. Elle dont la voix se brisait après cinq minutes de lecture, tiendrait-elle la distance sur 200 pages ? Et là encore, j’ai été surpris : la voix était là, dès le début, et elle tenait, avec cette histoire de deux cœurs perdus qui ne ressemblait à aucune histoire d’amour connue. Elle y peignait Paris en nuances de gris et ajoutait à chaque page de petites touches de couleur – comme Hannah, sa narratrice, qui grave la phrase-titre sur tous les bancs publics - « J’écris ‘Il y a si peu d’endroits confortables’ dans son cou et Paris me répond. »
Puis il y eut le roman, en 2010. Il y a si peu d’endroits confortables, c’était un beau titre, et il lui ressemblait. Là encore, j’ai eu très peur. Elle dont la voix se brisait après cinq minutes de lecture, tiendrait-elle la distance sur 200 pages ? Et là encore, j’ai été surpris : la voix était là, dès le début, et elle tenait, avec cette histoire de deux cœurs perdus qui ne ressemblait à aucune histoire d’amour connue. Elle y peignait Paris en nuances de gris et ajoutait à chaque page de petites touches de couleur – comme Hannah, sa narratrice, qui grave la phrase-titre sur tous les bancs publics - « J’écris ‘Il y a si peu d’endroits confortables’ dans son cou et Paris me répond. »

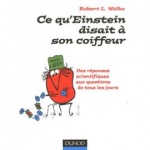 Il a beau se passer quelque chose à chaque fois que je vais chez mon coiffeur à 7 euros du bvd Ornano, ce matin je pensais vraiment qu’on ne parlerait que de météo
Il a beau se passer quelque chose à chaque fois que je vais chez mon coiffeur à 7 euros du bvd Ornano, ce matin je pensais vraiment qu’on ne parlerait que de météo